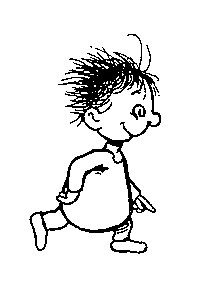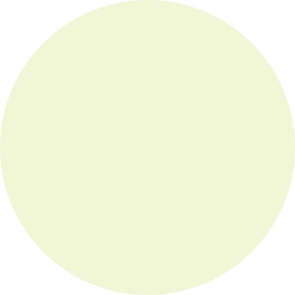
21
Fév 2019
Fév 2019
Presse
Vous êtes un gaucher irréductible. L’aboutissement d’un parcours du combattant ?
Quel souvenir en gardez-vous ?
Vous êtes devenu gaucher contrarié ?
Votre conscience féministe est donc née tôt…
Votre fibre féministe se retrouve dans tous vos albums…
Vous écoutez beaucoup votre fille. Vos parents ont-ils été à votre écoute ?
Vous avez continué de dessiner, à votre retour ?
Vous encourageait-elle à devenir artiste ?
Vous savez aujourd’hui pourquoi ?
En 1995, vous avez écrit un roman pour adultes, Les Pieds-Bleus, inspiré de ce traumatisme…
Vous avez ouvert un musée en ligne consacré aux œuvres d’art des enfants…
Les humains sont rares dans vos dessins…
Claude Ponti, une vie dédiée aux enfants
À LIRE
Claude Ponti » Les enfants sont d’une lucidité extraordinaire » in Télérama 23 Février 2019
Entretien
Marine Landrot
L’auteur-illustrateur Claude Ponti : “Les enfants sont d’une lucidité extraordinaire”
Génial tordeur de mots et illustrateur, l’auteur de “L’Album d’Adèle” illumine depuis plus de trente ans la vie des enfants. Il raconte le petit garçon qu’il était, violé par son grand-père, sauvé par le dessin. Son dernier album, “Le Fleuve”, est sorti en 2018.
Il est dring heure twouït twouït, Claude Ponti, le plus incroyabilicieux des auteurs illustrateurs français, a fêté ses 70 ans. Des poussins ont-ils gambadé en tous sens pour lui confectionner un gâteau d’anniversaire géant, comme dans son album phare Blaise et le château d’Anne Hiversère ? Les admirateurs de la première heure vénèrent le livre de ses débuts, L’Album d’Adèle (1986), inventaire à la Prévert qui fit date dans la littérature pour tout-petits.
Depuis trois décennies, il publie un nouvel album par an. Peuplées de créatures bizarres libres d’inventer les mots qu’elles veulent, ses histoires chantent la force de l’imaginaire dans des quêtes initiatiques. Son dernier livre, Le Fleuve, est une splendide fable écologique sur fond de réincarnation des grands-parents dans l’oreille de leurs petits-enfants. Encore aujourd’hui, quand Claude Ponti croise le regard d’un bébé dans sa poussette, il se dit dopé pour la journée. Quel moteur anime cet être éternellement rigolmarrant ?
Vous êtes un gaucher irréductible. L’aboutissement d’un parcours du combattant ?
Etre gaucher, on fait avec, mais mieux que les autres. Longtemps, face aux moqueurs, j’ai sorti ma liste de gauchers célèbres : Léonard de Vinci, Charlie Chaplin… Et puis j’enchaînais : « Hitler était droitier. Franco était droitier… » ! Aujourd’hui, je ne le fais plus, parce que c’est moins dénigré d’être gaucher. Mais le monde n’est toujours pas fait pour nous. Quand vous insérez votre carte bancaire dans un distributeur d’argent, la petite encoche pour le pouce est conçue pour la main droite. J’ai mis longtemps à accepter que les graves soient à gauche sur les pianos, et que la pédale d’accélération soit à droite dans les voitures ! Par chance, j’ai fait mes classes enfantines —comme on appelait la maternelle à mon époque — dans une école expérimentale où les maîtresses m’ont laissé être gaucher.
Quel souvenir en gardez-vous ?
Un paradis ! Elles appliquaient les méthodes de la grande pédagogue Germaine Tortel, qui s’est beaucoup intéressée aux dessins d’enfants, et qui faisait peindre aux élèves des fresques allant parfois jusqu’à 13 mètres de haut. Dans mon école, on peignait sur les murs, avec nos doigts, avec des manches à balai, des branches, des feuilles d’arbres, c’était fou ! On voyait le mari de la maîtresse fabriquer des marionnettes, construire des histoires, puis présenter un spectacle. L’héroïne était une petite souris, qu’on retrouvait ensuite dans notre cahier pour apprendre à écrire. On était quand même au début des années 1950, à Lunéville ! C’est mon exception culturelle à moi. Malheureusement, après, on a déménagé dans un petit village des Vosges. Quand je suis arrivé dans ma nouvelle école, gaucher écrivant au stylo-bille, j’ai souffert…
Vous êtes devenu gaucher contrarié ?
Je n’ai pas cédé ! Mais ils m’ont fait redoubler parce qu’ils trouvaient que j’écrivais trop mal à la plume Sergent Major. Ma mère était institutrice dans cette école. Mon année dans sa classe fut la pire. J’étais lent, probablement dyslexique, et elle ne le supportait pas. Je me suis pris de ces raclées devant les autres ! Un jour, elle m’a traîné chez la directrice, qui avait une classe de fin d’études de filles, où elles apprenaient la cuisine, la couture et le ménage. Il faut se représenter la scène : ma mère prend son garçon, elle le traîne sur le sol par un bras, en hurlant, et elle le jette dans la classe des filles, parce qu’un garçon est forcément humilié de se retrouver chez les filles ! Alors que c’est une femme elle-même ! Je me souviens m’être fait cette réflexion sur le moment, je trouvais ça incompréhensible.
“Les blagues à la con sur l’intelligence inférieure des femmes sont toujours restées inopérantes pour moi.”
Votre conscience féministe est donc née tôt…
J’avais une mère enseignante et un père ouvrier, donc les blagues à la con sur l’intelligence inférieure des femmes sont toujours restées inopérantes pour moi. L’intellectuelle, c’était ma mère. On était trois garçons, toujours à la défendre. Surtout que la domination masculine était forte à la maison, car j’avais un père très dur et très violent. Il a énormément surveillé ma mère. On avait une voiture, avec tout ce que représentait LA voiture, pour cette génération-là : le prestige, la libération, le statut social. Ma mère ne pouvait conduire que pieds nus, comme Françoise Sagan, parce que sinon elle ne sentait pas les pédales, ce qui énervait spécialement mon père. Devant la maison, il y avait un trottoir en terre, juste avant une descente pour aller au garage. Chaque fois que ma mère rentrait la voiture, mon père regardait les traces de pneu, et disait : « Tu t’y es mal prise. » Au bout d’un moment, ma mère en a eu marre, et elle a arrêté de conduire.
Votre fibre féministe se retrouve dans tous vos albums…
Comme jeune lecteur, je m’identifiais surtout aux personnages de filles en situation de contrainte ou d’exploitation. Quand j’ai commencé à écrire des albums jeunesse en 1986, pour faire un cadeau de naissance à ma propre fille, Adèle, j’avais envie de l’armer pour la vie. Mais les héroïnes de mes livres ont évolué. Dans mes premiers albums, elles se retrouvaient dans des situations malgré elles. En grandissant, ma fille m’a dit : « Ecoute, Papa, c’est énervant, tes personnages, ils subissent toujours. Moi, quand j’étais petite, je ne rêvais pas que le métro me conduise où je voulais, je rêvais de conduire le métro ! » Depuis, mes héroïnes prennent en main les événements.
Vous écoutez beaucoup votre fille. Vos parents ont-ils été à votre écoute ?
D’abord, je ne vivais pas tout le temps avec eux. A l’époque, les gens larguaient souvent leurs enfants, chez des cousins, des grands-parents… Donc quand j’avais 3 ans, mes parents m’ont laissé chez la sœur de mon père, qui avait fait une fausse couche. J’étais comme un enfant de remplacement. Lorsque mon père m’a déposé là-bas, je lui ai demandé combien de temps j’allais rester. Il a fait une réponse évasive, et j’ai négocié que si j’envoyais un dessin qui représentait une voiture sortant d’un tunnel dans une montagne, on viendrait me chercher. Evidemment au bout de trois mois, j’ai envoyé le dessin parfait, et personne n’est venu me chercher. Noël est passé, on n’est pas venu non plus. Ça a duré un an et demi. Quand on m’a ramené à la maison, j’avais un nouveau petit frère, et je n’ai pas reconnu ma mère.
Illustration extraite de son dernier album, Le Fleuve. « Les créatures composées du mélange animal-humain multiplient les possibilités d’identification libre. »
Vous avez continué de dessiner, à votre retour ?
Du matin au soir ! Peu à peu, ma mère a remarqué que je dessinais beaucoup, et bien. Alors elle a cherché à m’inscrire dans un cours de dessin, au château de Lunéville. Le prof ne comprenait pas qu’on mette un enfant de 6 ans dans cet atelier pour adultes, où une fois par mois il devait y avoir un nu… La première fois, il m’a installé à côté du poêle et m’a dit : « Dessine ce que tu veux. » Je crevais de chaud, je n’ai pas osé enlever mon manteau. Après le cours, je suis rentré chez moi à pied, tout seul. Cent mètres avant ma maison, il y avait l’ancienne prison, habitée par des pauvres. C’est la nuit, c’est l’hiver, j’ai de la fièvre, je longe le mur, et je vois un garçon de 12 ans qui s’approche de moi. Comme ma mère m’a toujours prévenu que les pauvres étaient dangereux, j’ai une réaction craintive, et il me défonce la gueule. Evidemment à la maison, on m’a dit que c’était de ma faute, et je ne suis plus allé en cours de dessin. Mais j’ai continué à dessiner tout seul. Par la suite, ma mère m’a même acheté de la peinture à l’huile dans une boîte en bois.
Vous encourageait-elle à devenir artiste ?
J’ai compris des années plus tard pourquoi elle avait valorisé mes talents artistiques. J’étais déjà adulte, et elle habitait à la campagne, dans une maison entourée de chats errants. Elle les nourrissait, mais elle râlait tout le temps : « Je comprends pas, je veux pas qu’ils viennent, je veux même pas qu’ils s’approchent de la maison. » Alors un jour, je lui ai dit : « Si tu n’en veux pas, pourquoi tu les nourris ? » Et elle m’a répondu : « Je les nourris pour qu’ils partent. » Là, je me suis dit d’accord, on m’a donné des peintures pour que je ne peigne pas, pour que j’arrête. Avec le recul, c’était quand même bizarre que mes parents me demandent de montrer mes œuvres dès que quelqu’un venait à la maison, car je faisais des peintures très violentes, exprimant un fort mal-être et de gros troubles d’identité, avec des gens écartelés, des ventres ouverts…
“Je n’aime pas la pudeur qui masque, j’aime la pudeur qui respecte l’autre.”
Vous savez aujourd’hui pourquoi ?
C’est tout simple. Entre 6 et 7 ans, j’ai été violé par mon grand-père maternel, à qui on m’avait confié quelque temps. Il m’a dit la phrase cruciale : « Tu n’en parles à personne, sinon… » Après le « sinon », il y avait ces trois petits points de suspension qui coupent la chique. Et derrière, le tabou, l’indicible, l’« indisable ». J’ai longtemps dessiné, probablement parce que dessiner n’apparaissait pas comme dire. Alors que ça disait, bien évidemment ! Aujourd’hui, je n’ai plus aucun scrupule à en parler. Je n’aime pas la pudeur qui masque, j’aime la pudeur qui respecte l’autre. Je pense qu’il faut dire les choses. Avec délicatesse, mais clairement.
J’ai vu récemment le très beau film Les Chatouilles, inspiré d’une histoire vraie d’abus sexuel. C’est un avis personnel, et lié à ma propre histoire, mais j’aurais aimé qu’on montre un peu plus ce que faisait l’ami de la famille. Quand il commence à s’occuper de la petite fille, et qu’on voit juste la main se glisser sous le drap, moi je revis des trucs d’enfant identiques, où je ne comprenais pas ce qui se passait. La puissance du « je ne comprends pas ce qui se passe » a masqué les choses pendant vingt ans. Je voyais qu’il y avait un problème mais je ne savais pas où il était. Je sentais que c’était grave mais je ne savais pas pourquoi. Ce doute est très dérangeant pour un enfant. C’est pour cela que je ne pratique jamais l’allusion, dans mes albums. Sinon, l’enfant ne peut pas comprendre à quoi l’adulte se réfère. Je préfère parler des choses en ouvrant une porte et en montrant qu’elles existent.
En 1995, vous avez écrit un roman pour adultes, Les Pieds-Bleus, inspiré de ce traumatisme…
J’ai mis trente ans à pouvoir l’écrire, et ce n’est qu’aujourd’hui, avec la libération de la parole sur les violences sexuelles, que je peux confirmer son caractère autobiographique. Quand Les Pieds-Bleus sont sortis, j’ai envoyé le livre à ma mère en me demandant comment elle allait réagir, parce que j’y parlais quand même très clairement de son père. Elle m’a dit : « J’espère que ça t’a apaisé. » Pas mal. Mais quinze ans plus tard, elle m’appelle : « Oh ! je viens de relire Les Pieds-Bleus, ça m’a plu, ça m’a rappelé plein de bonnes choses ! » Voyez comme les gens se construisent une histoire à eux, et suppriment petit à petit tout ce qui les dérange. C’est fabuleux de se tricoter sa bouée de sauvetage comme ça ! Je dis tricoter exprès, parce qu’on ne peut pas nager avec, on coule.
“Quand ma fille Adèle est née, je ne pouvais plus continuer à voir la vie en noir.”
Quand avez-vous choisi de voir la vie du bon côté ?
Quand ma fille Adèle est née, que j’ai eu cette enfant toute petite dans la main, et qu’elle m’a regardé. Elle m’a transpercé, elle a fait un trou dans le mur derrière moi. Je ne pouvais pas avoir été là pour que cet être existe et continuer à voir la vie en noir. Donc je suis passé du pessimisme établi, quasiment bourgeois, bien au chaud là-dedans, à un optimisme décisionnel, inébranlable. Et je suis devenu auteur de livres pour enfants. J’ai juste été le même bonhomme, avec la bouche dans l’autre sens, pour toujours. C’est graphique !
Vous avez ouvert un musée en ligne consacré aux œuvres d’art des enfants…
Le site s’appelle Muz, il existe depuis dix ans. La philosophie générale, c’est de dire que certaines œuvres d’enfants peuvent nous bouleverser autant que des œuvres d’adultes. Muz met des œuvres en ligne et organise quelques expositions. La première fois qu’on a exposé des vraies peintures d’enfants, en particulier de la collection de Germaine Tortel des années 1950, les gens étaient scotchés. Ils voyaient des portraits extrêmement puissants et ils découvraient qu’un enfant de 3 ans et demi les avait faits !
Maintenant, allez convaincre les décideurs de construire un bâtiment en dur, de le chauffer et d’y mettre des gardiens pour exposer des œuvres d’enfants, ils rigolent… Quand on a commencé à prospecter, quel dialogue de sourds ! « Vous voulez faire un musée pour les enfants, quoi… — Non, on veut exposer des œuvres faites par des enfants. — Ah, vous voulez organiser un concours de dessin pour les enfants ! »C’était laborieux, j’avais vraiment l’impression d’être au conseil d’administration de la SNCF et de proposer le concept d’avion. Tellement d’adultes traitent les enfants comme des quarts de bidules…
Les humains sont rares dans vos dessins…
Oui, parce que je n’arrive pas à les dessiner. Même quand je faisais des dessins de presse, je n’aimais pas reproduire les gens à l’identique, car je trouve qu’on ne voit plus la personne. J’ai vite compris que l’être hybride, il n’y a rien de mieux. Les créatures composées de différents animaux, ou du mélange animal-humain, multiplient les possibilités d’identification libre. Le lecteur entre et sort comme il veut, il peut passer de l’un à l’autre.
“Dans ‘Okilélé’, le héros, terrifié, supplie : “Pitrouille !’, un mélange de ‘pitié’ et de ‘trouille’.”
Vos textes sont pleins de trouvailles linguistiques. D’où viennent-elles ?
Il faut que ça chante, et que ça ait du sens. Parfois je cherche longtemps. Dans Okilélé, à un moment le héros est terrifié devant ses parents et il supplie : « Pitrouille ! » J’ai mis des semaines à trouver ce mélange de « pitié » et de « trouille ». Mais le plus souvent, il me suffit d’ouvrir les oreilles. Ma fille m’a beaucoup inspirée. Quand elle avait 2 ans et demi, son arrière-grand-mère est morte. Le corps a été exposé dans une petite chapelle. Ma fille a voulu y aller. Elle a regardé son arrière-grand-mère en restant dans mes bras. Et une fois dehors, elle m’a dit « C’est rigolo, elle est là et il y a personne dedans. » Ça m’a tué ! J’ai glissé cette phrase dans L’Arbre sans fin.
C’est des âges où les enfants sont capables d’une lucidité extraordinaire. Certains adultes diront qu’on interprète leurs paroles. Moi, je leur accorde le crédit de penser profondément ce qu’ils disent. Ils sont en prise avec les choses et il faut les écouter. Les enfants sont honnêtes, ils sont directs. Entre eux et moi, il n’y a aucun mensonge, aucun trafic, on fait semblant de rien. Dans mes albums, je garde toujours à l’esprit qu’un enfant est une personne qui grandit, qui apprend, qui essaie, qui se développe. Mes histoires lui proposent de se comprendre un peu, de prendre le temps de rater.
Que changeriez-vous dans votre vie, si vous aviez une « baguette magique bien cuite », comme votre héroïne Isée ?
Rien. Si je changeais un truc, je ne serais plus moi. Or cela m’a demandé beaucoup de boulot d’être moi. C’est ce qui m’angoisse avec la mort : l’idée d’avoir réussi à construire toute cette vie, et qu’elle disparaisse un beau jour sans que je sache plus jamais qu’elle a existé. Je trouve ça un peu fâcheux. J’ai conscience de ma chance de faire ce que j’aime, d’aimer ce que je fais. J’ai reçu des lettres d’enfants tellement magnifiques qu’elles me portent encore aujourd’hui. Etre président de la République, c’est rien à côté ! En plus, parfois vous êtes président de la République parce qu’on a voté pour ne pas avoir quelqu’un d’autre. Moi, quand on achète mon livre, c’est pour avoir mon livre, pas pour éviter d’acheter le livre d’un autre !
Claude Ponti, une vie dédiée aux enfants
1948 Naissance à Lunéville.
1968-1984 Dessinateur à L’Express.
1986 L’Album d’Adèle.
1999 Sur l’île des Zertes.
2004 Blaise et le château d’Anne Hiversère.
À LIRE
Le Fleuve, de Claude Ponti, éd. L’Ecole des loisirs, 60 p., 18,80 € .
La Fabrique de Claude Ponti, d’Adèle de Boucherville, éd. L’Atelier du poisson soluble, 208 p., 32 €.