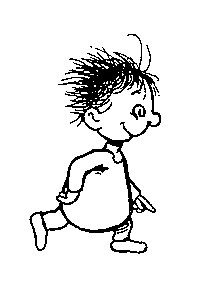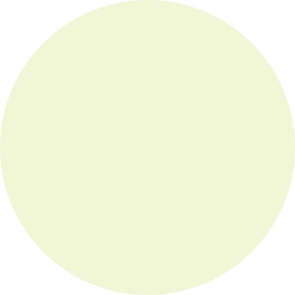
01
Mar 2019
Mar 2019
Presse
Début décembre, dans un café en face de la gare de Château-du-Loir (Sarthe), où il réside, il se met à dire :Quand j’étais petit, à 3 ans et demi, mes parents m’ont mis en pension chez ma tante, pendant un an et demi. Ma tante avait fait une fausse couche, j’étais le petit de remplacement. Dès qu’elle a été enceinte, j’ai pu repartir. Mais pendant tout ce temps, à chaque fois que mes parents devaient venir me chercher, ils sont pas venus. C’est-à-dire que moi, j’avais 3 ans, j’avais passé un contrat avec mon père : si je voulais rentrer, je devais lui envoyer un dessin d’une voiture qui sortirait d’un tunnel dans une montagne. J’ai envoyé le dessin et ils sont pas venus.
Claude Ponti parle des monstres dans l’ Obs…
…ceux de ses livres et les autres .
copyright Audrey Cerdan
Pour voir l’article complet de Nolwen Leblevennec dans le Nouvel Obs c’est ICI
Nous reproduisons ci-dessous le texte de l’interview
C’est parce qu’on essaye, de façon un peu maladroite, de faire un lien entre son génie artistique et ses premiers traumatismes, que Claude Ponti, 70 ans, auteur culte de livres pour enfants (7,8 millions d’exemplaires écoulés en français), part ce jour-là dans ses souvenirs d’enfance. C’était dans la campagne vosgienne, l’époque post-guerre où, dit-il, les parents considéraient les enfants comme des objets leur appartenant et des barreaux d’échelle sociale. L’écrivain, frappé par son père et violé par son grand-père maternel, a aussi été abandonné par ses parents au tout début de sa vie.
Début décembre, dans un café en face de la gare de Château-du-Loir (Sarthe), où il réside, il se met à dire :Quand j’étais petit, à 3 ans et demi, mes parents m’ont mis en pension chez ma tante, pendant un an et demi. Ma tante avait fait une fausse couche, j’étais le petit de remplacement. Dès qu’elle a été enceinte, j’ai pu repartir. Mais pendant tout ce temps, à chaque fois que mes parents devaient venir me chercher, ils sont pas venus. C’est-à-dire que moi, j’avais 3 ans, j’avais passé un contrat avec mon père : si je voulais rentrer, je devais lui envoyer un dessin d’une voiture qui sortirait d’un tunnel dans une montagne. J’ai envoyé le dessin et ils sont pas venus.
Après, ils ont dit « on va venir pour Noël », et ils sont pas venus. Quand je suis rentré chez mes parents, j’avais un nouveau petit frère, et je ne reconnaissais plus mon grand frère. On m’a dit « va jouer dans la cour », il y avait trois garçons qui jouaient et je ne savais pas lequel c’était. J’étais parti presque la moitié de ma vie. Donc plus tard, quand ils m’ont remis en pension chez mon grand-père, en sixième, je pensais que c’était ma vocation, que c’était comme ça qu’on m’aimait, loin et absent.
Claude Ponti s’étonne du désarroi général que produisent ses souvenirs. «Bah, faut pas prendre cet air triste, c’est pas grave.» Dans «les Pieds Bleus», roman pour adultes et presque autobiographique, rien ne lui semble grave non plus. Il raconte, sans larmoyer (il pourrait dire «sans larmoyance»), l’histoire d’un garçon tapé par son père, brutalisé par son maître et dont les deux petites voisines se font écraser par une voiture. Version montagnarde du Momo de «la Vie devant soi» d’Emile AjarAdèle est arrivée
Claude Ponti, Ponticelli initialement, a une taille relativement petite (l’allure d’un homme italien des années 1960). Des sourcils blancs et broussailleux qui se soulèvent, comme tout le reste du visage, quand il sourit. Une implantation de cheveux en palmier de chef d’orchestre ou de prof de physique. Il vit la plupart du temps dans une ancienne maison de curé avec une allée de tilleuls et du gravier, où il dessine sur de la musique japonaise ou éthiopienne.
Il va «pas mal bien». Son père «rital» est décédé. Sa mère, avec qui il a rompu, est en maison de retraite. Et lui ne changerait pas sa vie parce qu’il a «plein de chance». Après avoir réussi à ne pas devenir professeur de français comme ses parents le voulaient, après avoir fait les Beaux-Arts et peint des visages de femmes ouverts en deux (il fait un signe pour dire qu’il était toc toc), après avoir été coursier et dessinateur de presse, puis directeur artistique d’une imprimerie, il est devenu auteur de livres pour enfants à la naissance de sa fille Adèle, en 1985. Le seul repère spatio-temporel de sa vie :
Quand Adèle est arrivée, elle était minuscule. Elle a dû faire un peu de boîte en verre et dès que j’ai pu, je l’ai prise dans la main et je l’ai présentée au monde. Quand elle m’a regardé, elle m’a collé au mur. Jamais je n’avais ressenti un truc aussi puissant. Et je me suis dit qu’avec une personne pareille, je ne pouvais pas continuer de dire que le monde était de la merde. J’ai eu envie de faire des choses pour qu’il soit un peu meilleur.
Claude Ponti a trouvé à cet instant sa place dans le monde en dessinant, non pas des livres-médicaments, mais des livres-pourvoyeurs-de-confiance-pour-des-enfants-en-construction-qui-pourraient-on-sait-jamais-se-retrouver-seuls-face-à-leurs-blocages.
En trente ans, près de 80 albums, il a donné vie, entre autres, à Blaise, Pétronille, Jules, Oups, le Petit Prince Pouf, Isée. Des petits personnages qui sont des professionnels de la rhétorique, de l’échappatoire et de la solution personnelle. Dans ces livres, il a inventé des mots comme «éclapatouiller» (tapoter), «embrouillaminé» (être sonné), «sloumpy-sloumpy» (être vraiment amoureux), «épouzeurs» (types qui veulent se marier pour de mauvaises raisons). Et écrit des phrases jolies comme :
Le bois de chauffage ne manque pas, elle n’aura pas froid, ce qui est très important quand on est orphelin.
Il a créé des monstres gentils comme les «grobinets», des robinets voluptueux à gros ventres, et des monstres méchants comme le «Martabaf», un marteau qui frappe sans discernement, ou le «Grabador Crabamoor», un être mi-samouraï, mi-crustacé.
Je trouve sensuelles les articulations des crabes, je fais collection de carapaces. Mais je ne dessinerais pas d’araignées qui sont dans un registre trop phobique. Je veux jamais faire des monstres qui font vraiment complètement peur.
« J’ai découvert Freud à 14 ans »
Dix ans après la naissance d’Adèle, en 1995, Claude Ponti a également écrit «le Chien invisible», qui est le plus beau livre de la littérature pour enfants. On y suit Oum-Popotte qui vit avec des parents en carton (littéralement), avant qu’un chien invisible et empathique ne vienne égayer la situation.
Quand on se sent seul, on idéalise les copains. Moi, j’avais un désir de copains parce que j’ai toujours eu du mal à garder les miens. Déjà, parce qu’ils déménageaient. Ensuite, parce que ma mère enseignait dans le village où on habitait, donc ça rendait les choses difficiles parmi les élèves de la classe. Et puis, il y avait aussi mon père qui travaillait à l’usine Clairefontaine, où on travaillait à la pièce. Et son boulot, c’était de mettre les gens à leur place. Suivant qu’on avait une bonne place ou pas, on gagnait plus ou moins d’argent. Donc on n’était pas aimés.
Claude Ponti récuse gentiment le mot «imagination» pour parler de son travail. Quand il a un personnage en tête, qu’il se sent «profondément avec lui», il l’accompagne dans un périple qui est lié à des questions qui l’habitent à ce moment-là. S’il a collé 120 petits à Pétronille, c’est parce que son emploi du temps a été débordé par la naissance d’Adèle.
Ce que je raconte, c’est la réalité habillée autrement.
Son travail n’a rien à voir non plus avec les drogues, comme il l’a des fois entendu. Son oreille interne étant sensible, sa seule expérience avec le «hash» s’est mal finie : une nuit, dans le lit d’une ferme nancéenne, à avoir la sensation de tomber. Mais il est vrai que ses récits sont désinhibés, comme ceux des rêves ou des divans psychanalytiques. C’est ce qui fait que ses histoires sont aussi vraies qu’un tableau de Dali.
J’ai découvert Freud à 14 ans, dans une revue que lisait ma mère. Plus tard, j’aimais beaucoup des peintres comme Brueghel ou Bosch, tous ces artistes qui travaillaient dans la réalité en bordure, et je me suis intéressé au surréalisme qui s’intéressait lui à l’inconscient. Plus tard, j’ai lu les bouquins de Jung, dont je comprenais la moitié, mais j’ai intégré l’idée d’individuation, c’est-à-dire de se fabriquer en tant qu’individu.
« Je te tue dans ma vie »
Dans «Mô Namour», sorti en 2011, Isée, une adorable petite fille au visage en forme de pomme de terre, se fabrique en tant qu’individu après avoir subi des violences sexuelles métaphoriques. «Il s’agit d’une enfant qui se fait embarquer dans quelque chose et qui ne voit pas à quel point c’est autre chose», dit Claude Ponti, qui a aussi écrit un texte pour adultes essayant de décrire «comment on se sent face à des violences sexuelles».
A la suite d’un accident de voiture, Isée, qui se croit devenue orpheline, rencontre un grand gars à l’air inoffensif qui s’appelle Torlémo Damourédemorht. Le benêt lui propose de devenir son ami et de jouer avec lui à la «baloune». Isée est d’accord : quand on n’a plus de parents, les amis peuvent être utiles. Mais ce que lui propose en fait le grand gars est d’entrer dans la «baloune» pour qu’elle soit bien gonflée et qu’il puisse mieux shooter dedans. Isée prend des coups toute la journée. Jusqu’à ce qu’une étoile lui ouvre les yeux. Alors Isée crie à Torlémo :
Je ne veux plus jouer avec toi, ni que tu joues avec moi. Jamais. Je ne suis pas une baloune, ni une balle de golf ou de tennis ou de ping et pong, je ne suis pas un volant, ni une boule de pétanque, je m’appelle Isée… Et je te tue dans ma vie, je te tue dans mes souvenirs, je te tue dans mon avenir, je te chasse d’eau, je te poubelle, je te hais, je te couche-culotte pleine !
(Les personnages de Claude Ponti sont souvent éruptifs comme ça quand on les emmerde. On conseille aux parents de déclamer ces passages.)
« Mon grand-père, c’était l’idole »
Dans le deuxième tome, «la Venture d’Isée», la petite fille repousse tous les hommes qui admirent sa force et veulent l’épouser pour, in fine, entraver son excellente venture. Le féminisme, c’est venu avec sa fille ?
Non, je l’étais avant. Je suis né en 1948, donc enfant j’entendais plein de blagues sur les femmes qui sont cons, qui ne devraient pas voter, et c’était incompréhensible pour moi parce que ma mère instit ne manquait jamais une occasion de dire qu’elle était supérieure intellectuellement, et que mon père était un manuel. Cela ne tenait pas debout. Et puis, deuxième raison, j’ai été violé par mon grand-père, donc la domination masculine, c’est pas mon truc.
C’était en sixième. Claude Ponti avait été mis en pension pour la seconde fois de sa vie. Chez son oncle et sa tante avec lesquels habitait son grand-père.
C’était un peu chiant, parce que mon oncle et ma tante regardaient la télé le soir et moi je montais me coucher, et après mon grand-père montait aussi se coucher, donc est-ce qu’il venait ou est-ce qu’il ne venait pas. Ce qui était un peu chiant aussi, c’est que mon grand-père, c’était l’idole. Il était officier cuirassier pendant la guerre de 14, à cheval et médaillé, et plutôt humain puisqu’il disait que c’était dégueulasse de saouler les hommes avant de les envoyer à l’attaque. Donc, comment dire, tous les gens qui se posent comme l’autorité, les personnes absolues à respecter, moi, je ne peux pas, ça ne marche pas.
Ce qui marche avec lui, ce sont plutôt les personnes éparpillées, et c’est à ce moment-là qu’on l’a entendu dire, comme si c’était socialement tranquille pour un homme, qu’il s’était toujours beaucoup identifié à Emma Bovary. La lecture du roman de Flaubert l’a «changé sur plein de choses».
Moi, c’est très simple, je m’identifie aux victimes. Comme la plupart du temps, ce sont des femmes dans les bouquins, je m’identifie à elles.
Bigflo et Oli
Sur son compte Twitter, Claude Ponti soutient effectivement toutes sortes de victimes. Celles de #Metoo, celles des prothèses vaginales, mais aussi les étudiants africains qui s’inquiètent de la hausse des droits d’inscriptions à l’université, les infirmières en manif ou Rafa et Aysha, deux sœurs menacées d’expulsion au Bangladesh.
En fait, l’auteur, qui s’est aussi activement opposé à la présence «sinistre» de McDonald’s au Salon du livre de la jeunesse de Montreuil, a la colère intacte et la souplesse d’esprit d’un Jean Rochefort : aucune marque de repli mental sur lui-même.
Dans son dernier livre, «le Fleuve», sorti en septembre, il raconte l’histoire des Oolongs et les Dong-Ding, deux peuples véganes et «gender-fluid», qui font une natte aux garçons, trois aux filles, et cinq aux «enfants qui ne savent pas encore si elles seront fille ou garçon».
Sur ces questions de genre, il admet être parti de loin :
A mon époque, on était un garçon, on était une fille, et, éventuellement, on était pédé et c’était grave. J’ai une prononciation un peu précieuse, je ne sais pas d’où elle me vient, mon père ne supportait pas ça. Sur l’identité sexuelle et le genre, je me suis fait complètement rééduquer par ma fille.
Claude Ponti, qui pensait devenir un vieux con avec un fusil à la main, a pris le chemin inverse. Il lui arrive de déjeuner avec les rappeurs BigFlo et Oli. En rentrant d’un concert au Mans, la dernière fois, les frères toulousains sont passés le voir, entourés de leurs gardes du corps (le village s’en souvient encore).
Dans une lettre, ils lui avaient écrit que ses livres les avaient aidés à traverser des choses dont il ne peut rien nous dire.
Et quand il ne répond pas gentiment à des lettres d’enfants et qu’il est seul chez lui, ce qui est bien aussi, il lit avidement «l’Amie prodigieuse» d’Elena Ferrante. C’est un de ces hommes-là.
Nolwenn Le Blevennec
En août dernier, Claude Ponti et Marie Desplechin ont sorti « Enfances », qui raconte des moments « importants et déterminants » de la vie de plus de 60 enfants.