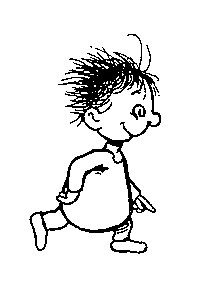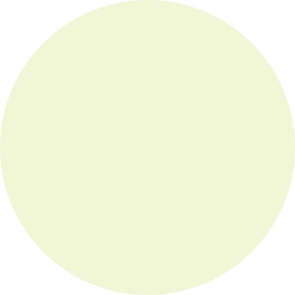
Déc 2020
Entretien avec Claude Ponti – Le Monde
Claude Ponti « La naissance de ma fille m’a retourné comme un gant »

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉ LÀ SI… « Le Monde » interroge une personnalité sur un moment décisif de son existence. Cette semaine, l’auteur d’albums pour la jeunesse, devenu un « optimiste décisionnaire » en 1985, évoque les traumatismes de son enfance qui imprègnent son œuvre.
Auteur majeur de la littérature de jeunesse, Claude Ponti, 72 ans, est le créateur d’une œuvre féerique et inventive, derrière laquelle se tapit une certaine gravité. Le créateur d’albums aussi inoubliables que L’Arbre sans fin (1992), Okilélé (1993) ou Le Doudou méchant (2000) sort une version grand format de Blaise et le Château d’Anne Hiversère (2004), à l’occasion des fêtes. Tous ces albums ont été publiés à L’Ecole des loisirs.
Je ne serais pas arrivé là si…
Si ma fille Adèle n’était pas venue au monde, en 1985. J’ai voulu lui offrir un cadeau pour sa naissance, un cadeau fabriqué à la main que je n’aurais acheté nulle part. Comme la seule chose que je savais faire était dessiner, je lui ai fait un album. C’est comme cela qu’a été conçu L’Album d’Adèle (Gallimard, 1986), un livre grand format à poser par terre, avec le bébé à côté – un livre avant les livres, avant la lecture. Rien ne me destinait alors à la littérature de jeunesse. J’étais peintre et, pour gagner ma vie, je travaillais comme dessinateur de presse à L’Express, où j’avais été coursier auparavant, pendant quatre ans.
Vous étiez une sorte de peintre maudit, c’est ça ?
J’étais quelqu’un d’assez pessimiste. Mes parents s’étaient violemment opposés à ma carrière artistique. J’avais la rage, et je pense que je l’ai toujours aujourd’hui. Je ne croyais en personne, surtout pas en moi. Ma peinture s’en ressentait. Je peignais de manière réaliste des choses qui n’existaient pas. C’était assez exaltant dans la mesure où j’ignorais le syndrome de la page blanche : ça sortait, il fallait que j’élimine. Et puis est arrivé cette enfant. On ne décide pas d’avoir un enfant, mais on ne décide pas non plus de ne pas en avoir : tout se passe comme si c’était lui qui voulait venir. Sa naissance m’a retourné comme un gant. Complètement. Le pessimiste que j’étais est devenu un optimiste décisionnaire.
Ce fameux « Album d’Adèle », devait-il être publié ? Non. Le jour où j’ai été viré de L’Express, j’ai démarché ici et là, notamment chez Gallimard, qui publiait une revue pour adolescents, Piranha. J’avais apporté avec moi une double page de L’Album d’Adèle afin de montrer dans quel style j’aimerais travailler. Les gens de Piranha m’ont envoyé sur le palier d’en face où Geneviève Brisac, l’éditrice jeunesse de Gallimard, avait son bureau. C’est elle qui a insisté pour qu’on publie le livre. L’album a connu un succès d’estime. J’en ai fait un autre derrière (Adèle s’en mêle, Gallimard, 1987), et tout s’est enclenché.
Vous disiez à l’instant que vos parents s’étaient « violemment » opposés à votre carrière artistique…
Mon père, arrivé d’Italie en Lorraine à l’âge de 2 ans, avait été ajusteur, puis menuisier, pour finir cadre moyen dans une usine. Il était persuadé qu’il ne pourrait jamais aller plus haut du fait de son manque de qualification. C’était un pur Rital. Il était orgueilleux, en particulier en matière de qu’en-dira-t-on. Il était également violent, au point d’avoir développé une certaine imagination pour détourner des outils de leur fonction afin de vous mettre une raclée. Ma mère, de bourgeoisie commerçante décatie, était enseignante et ne manquait jamais une occasion de rappeler qu’elle était une intellectuelle, contrairement à son manuel de mari. Elle nous disait aussi qu’en matière de mariage, il nous faudrait éviter absolument les mésalliances. Nos destins étaient tracés : je deviendrais prof de français, mon frère aîné architecte et mon frère cadet médecin. Quand mes parents ont compris que je voulais me lancer dans une carrière artistique, cela a été la guerre.
Quand ont-ils réalisé que c’était le bon choix ?
L’un de mes frères est devenu saxophoniste de jazz. Jusqu’à nos 40 ou 50 ans, nos parents ont continué de nous dire, à lui et à moi : « Mais quand est-ce que vous aurez un vrai métier ? ». A un moment, ils m’ont pompé l’air. Je me suis arrangé, un jour, pour dédicacer mes livres dans un bourg à côté de chez eux. Quand mon père a vu la file d’attente, il a compris qu’il y avait de la sueur derrière tout ça. Je suis devenu encore plus sérieux à ses yeux le jour où j’ai pu acheter un appartement à Paris.
N’est-ce pas votre mère, pourtant, qui vous a orienté vers le dessin ?
Si. Elle m’avait inscrit à un cours de dessin à l’âge de 6 ans et m’avait ensuite offert une boîte de peinture vers 13¬14 ans. C’est bien plus tard que j’ai compris sa véritable intention, à travers la relation qu’elle entretenait avec un chat de gouttière très malin, qui venait souvent à la maison. Ma mère, ne voulant pas de chat chez elle, le chassait à chaque fois qu’il s’approchait de la nourriture… qu’elle-même lui apportait. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait cela. « Je lui donne à manger pour qu’il parte », m’a-t-elle répondu. J’ai compris, ce jour-là, qu’elle avait fait pareil avec moi en m’offrant une boîte de couleurs.
Dans « Les Pieds Bleus » (L’Olivier, 1995), roman en partie autobiographique, vous évoquez les abus sexuels que vous avez subis, enfant, de la part de votre grand-père…
C’était le père de ma mère, c’était aussi son idole. J’avais 8 ans quand il a commencé. On n’imagine pas la puissance d’une telle chose. En 6e, j’ai été mis en pension chez mon oncle, qui vivait chez mon grand-père. On mangeait le soir devant la télé et je montais me coucher après Bonne nuit les petits. Il y avait alors ce moment atroce de conscience de l’horreur, pendant lequel je l’entendais monter les marches. Je me demandais s’il allait s’arrêter dans ma chambre ou pas. Quand il s’arrêtait, ça pouvait durer un certain temps. Le plus incroyable fut ma capacité à occulter cela : dans la journée, mon grand-père restait en effet mon grand-père. J’avais 15 ans quand il est mort : j’ai alors ressenti une immense tristesse et une immense joie en même temps, sans comprendre pourquoi.
En avez-vous parlé à vos parents ?
Oui, vers l’âge de 25 ans, après que tout me soit remonté brutalement. Ils m’ont alors viré de la maison et notre brouille a duré sept ans. J’étais un monstre à leurs yeux, un obsédé sexuel. Mon père a minimisé les faits : « Moi, à l’usine, je me suis fait passer la bite au cirage, c’est pas grave ! » Il a alors demandé à mes frères de cesser toute relation avec moi. Ma mère en a souffert, en revanche. Non pas parce que j’avais été victime d’agression. Elle a souffert de l’atteinte à son père. Elle a souffert de ce que ça la faisait souffrir. C’était un héros pour elle, il avait fait la première guerre mondiale et en avait rapporté des médailles, il avait été officier cuirassier… Bien des années plus tard, alors qu’un instituteur soupçonné de pédophilie s’était suicidé dans la région, elle m’avait expliqué que tous les enfants sont des menteurs.
On comprend mieux pourquoi vous recommandez aux enfants d’être méfiants dans vos livres, notamment dans « Mô¬Namour » (L’Ecole des loisirs, 2011) où la petite Isée, après l’accident de voiture de ses parents, est recueillie par un géant, Torlémo, qui va s’avérer particulièrement violent avec elle…
On peut mettre ce qu’on veut dans cet album, y compris le thème de l’abus sexuel. Malheureusement, il faut se méfier de tout le monde. Mais comme je ne peux pas l’exprimer aussi explicitement, j’imagine des monstres qui ont une bonne gueule et qui peuvent être sympas. Derrière cela, il y a l’idée que l’enfant, qui est une personne en train de se construire, peut apprivoiser la peur en s’identifiant à un personnage.
Vos lecteurs devenus adultes disent souvent qu’ils appréciaient vos livres car vous ne les preniez pas pour des abrutis…
Tout auteur de littérature jeunesse vous dira la même chose, qu’il faut tenir compte de « l’intelligence » de l’enfant…
Oui, mais tous ne parlent pas de la mort, de la difficulté à se construire, des choix à faire dans l’existence…
Je tiens sans doute cela d’un autre traumatisme. A l’âge de 3 ans, j’ai été mis en pension chez ma tante et mes grands-parents paternels, qui étaient voisins. Ma tante avait fait une fausse couche et perdu son bébé : bref, j’ai fait l’enfant de remplacement, l’enfant médicament, jusqu’à ce qu’elle soit enceinte. Je suis rentré chez moi un an et demi plus tard. Ce sentiment d’abandon est épouvantable, et tragicomique également : pourquoi moi ? La question reviendra avec mon grand-père : pourquoi moi ? Ce truc vous étreint longtemps après.
Savez-vous ce que retiennent les enfants de vos livres ?
Non, mais je fais attention à ce que les parents ne puissent pas les interpréter à leur place. Quand un adulte lit un livre à un enfant, il a tendance à livrer son interprétation du texte par son ton, par son phrasé, afin que l’enfant comprenne ce qu’il veut lui faire comprendre. Je me bats farouchement contre ça. J’essaie, du coup, de ne pas être univoque dans mes albums.
Faire confiance aux enfants : n’est-ce pas là, finalement, le grand message de votre œuvre ?
Comme en toute littérature, il faut faire confiance au lecteur, sinon on ne fait que des tas de papier. Que les enfants entreprennent d’avoir confiance en eux, alors qu’ils sont en construction d’eux-mêmes, est essentiel. Il ne sert à rien de leur dire : « Ne parle pas aux inconnus. » Primo, parce que la moitié de ceux qui abusent des enfants ne sont pas des inconnus ; secundo parce qu’à partir du moment où un inconnu parle à un enfant, il cesse d’être un inconnu à ses yeux. Un enfant acquiert de la confiance en lui à travers des personnages auxquels il peut s’identifier, à son gré, dans des situations qu’il peut apprivoiser à son rythme.
A cette fin, vous utilisez le féerique, le merveilleux, la fantaisie. D’où cela vous vient-il ?
De mon goût pour les contes. J’ai aussi beaucoup lu de science-fiction, sans oublier Freud, que j’ai découvert à 14 ans, mais aussi Jung ou Marie-Louise von Franz. J’ai toujours été très contemplatif, par ailleurs. Vous me mettiez, bébé, dans un berceau sous les arbres, vous étiez tranquille pendant trois heures. Dans les Vosges, où j’ai grandi, je « lisais » la forêt quand d’autres lisaient des livres.
Essayez-vous de renouer avec les émotions de l’enfance quand vous écrivez ?
Elles viennent comme elles veulent, mais je trie en virant les clichés. Un des critères qui résistent à tout est de faire des albums que j’aurais aimé lire quand j’étais petit. Dès qu’une histoire se forme dans ma tête, il survient un moment magique : je passe totalement au service de cette histoire, je ne fais que ce qui est bien pour elle. Je crois beaucoup à la notion de « contenu manifeste du rêve indissociable du contenu latent » décrite par Freud, ainsi qu’aux soustextes des contes traditionnels qui nous parlent finalement beaucoup plus. Quand j’écris, j’essaie d’être en connexion avec ce monde latent et sous-terrain. C’est souvent trois ou quatre ans plus tard que je peux expliquer rationnellement les tenants et aboutissants d’un livre.
Le processus est-il identique à propos de vos inventions langagières, « irrésistibilicieusement incroyabilicieuces » comme il est dit dans « Blaise et le château d’Anne Hiversère » ?
J’ai beaucoup observé ma fille Adèle et ses amis. Un jour, devant une fontaine du Palais Royal, où flottait de l’écume, elle me dit « moustache ». Pourquoi me parlait-elle de moustache ? Tout simplement parce qu’elle avait prononcé une phrase, en désignant l’écume : « Voilà une tache de mousse ». A partir de là, tout est possible. J’invente aussi certains mots parce que je n’en ai pas sous la main, ou parce que je n’ai pas envie d’employer ceux qui existent. Ou tout simplement parce qu’ils produisent une belle musique à l’oreille.
Si vos histoires abordent des sujets graves, elles se terminent toujours bien. Pourquoi ?
Quand ma fille était petite, je pensais qu’il fallait raconter Le Petit Chaperon rouge de façon dure : « Si tu ne fais pas attention à ce qu’on te dit, tant pis pour toi ». Et puis, elle a vu La Petite Sirène, de Disney, qui se termine bien, alors que le conte originel, d’Andersen, se finit tragiquement. Nous avons eu une longue discussion à ce sujet, et nous sommes arrivés à la conclusion que les deux versions étaient vraies et complémentaires. Elle-même était capable d’accepter la version dure d’Andersen et de préférer celle, plus douce, de Disney. Pour revenir au Petit Chaperon rouge, la vérité est que sa maman est une mère monstresse. Comment peut-elle envoyer sa fille à l’abattoir, en forêt dans les bras du Loup sans préparation ni protection ?
Que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez gardé votre âme d’enfant ?
Cela me met en colère ! Vous avez vu l’enfance que j’ai eue ? Vous voudriez que j’y reste, ou que je la prolonge ? Non. Je suis super content d’avoir grandi. Je n’ai pas oublié pour autant l’enfant que j’étais.
Propos recueillis par Frédéric Potet